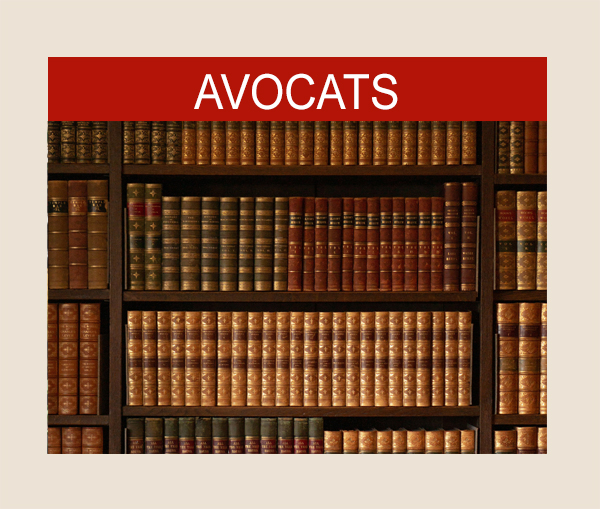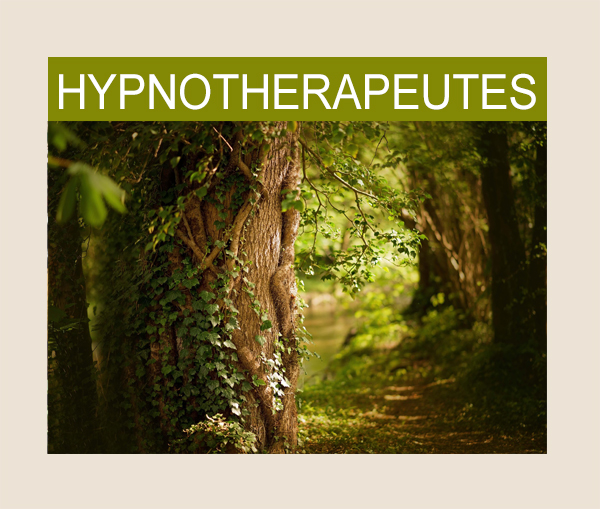Par Xavier Braeckman
 |
|
Cette nouvelle de Xavier Braeckman a été inspirée |
à Nils
Fortaleza, 14.05.1807
Cette histoire ne commence pas ici, assis à ce bureau vermoulu, les mains tremblantes de n’avoir pas dessoulé depuis trois nuits, hagard de rhum, la plume tremblante dans ma main.
Elle ne commence pas dans cette chaleur déjà étouffante du petit matin. Elle débute au printemps de l’année 1789, j’avais 15 ans alors et faisais partie des hommes de sa majesté le Duc de Bourgogne qui se rendait aux Etats généraux, convoqués par le roi pour sauver les caisses d’un Etat ruiné par les fastes d’une poignée et qui allait bientôt tout à fait s’écrouler.
Le soleil d'avril chauffait doucement les vignes du Duché.
«- Oi Alma, qu’est ce tu fais ?
- T’occupe, rendors toi
- Me parle pas comme ça, au matin, allez, viens
- Dis-moi comment tu t’appelles ?
- Dame de cœur, tu le vois pas mon nom là, tatoué sur l’épaule ?
- Non ton vrai nom, donne moi ton vrai nom
- Ça je peux pas te le dire
- Fous-moi la paix, alors, fous le camps »
Je lui jette la serviette au visage, rate mon tir. Elle ne bouge pas, le jour se lève à peine dans la baie de Fortaleza, deux trois-mâts cliquettent au gré de l’alizé qui se lève paresseusement. Un nègre rame debout à l’avant de son bwa fuyé depuis l’estuaire vers le large.
Petit déjeuner avec ma métisse, Dame de cœur, donc. J’ouvre une bouteille, avale une grande lampée, grimaces.
Je pose ma bouteille, je pose ma plume et je retourne me coucher auprès de ma métisse.
Fortaleza, 16.05.1807
Les deux dernières journées n’ont été que les successions des précédentes bacchanales. Depuis notre retour en mer, je n’arrive plus à contrôler mes humeurs, et je m’oublie dans la touffeur de la foret.
Eh bien, que diable, nous les méritons ces plaisirs, trois mois de mer depuis Bacoumpou en Guinée, trois mois de tangage et de roulis. Nous avons connu la lancinante attente du vent dans le pot au noir, ses orages imprévisibles, nous nous sommes perdus dans une tempête au milieu de ce grand vide de l’océan, pantin effrayé à l’idée d’errer jusqu’à Dieu loin des rives hospitalières de la terre ferme. Et puis bien sûr, pendant tout ce temps, il y avait la cale, ses râles.
Et aucune femme. Alors aujourd’hui on boit, on danse, on mange et on séduit des femmes aux corps vendus au plus offrant, et demain… ?
Ce journal m’est pénible à écrire, j’ai envie d’oublier.
J’aurais du lâcher le journal de bord à bord. Ne plus louvoyer avec le présent. Ne plus chercher à comprendre ce que je deviens.
Demain j’irai voir le docté-fey, qu’il invoque pour moi Dieu ou Damballah, qu’il me drogue ou me morde mais qu’il extirpe ces mois de mer, ces visages, cette odeur de cale.
Fortaleza, 17.05.1807
« - allez, dis-moi ton nom, dis moi comment tu t’appelles vraiment ?
- Dame de cœur, mwen ka di !…
- Me parle pas comme ça, ma jolie métisse
- Ne cherche pas à me connaître ti’blan, avec mon nom. Et puis je te l’ai déjà dit je ne suis pas métisse je suis une mamelouke
- et c’est mieux ?
- c’est plus blanc »
Ses yeux se durcissent, elle me dévisage de haut en bas avec cette morgue que je n’ai vu que dans les yeux de ces métisses, puis se retourne. Sa colère toute entière condensée dans le mouvement de sa chevelure.
La chaleur nous submerge, je me ressers de la bouteille. Ma métisse a disparu.
Je n’avais jusqu’à présent jamais quitté le château du Duc, mon univers se limitait alors à l’écurie où mon père avait réussi à se faire nommer premier palefrenier. Mon rôle, se limitait donc à racler le sol des Ecuries Ducales des immondices déversées par ces bêtes de race capricieuses et bornées qui valaient aux yeux de tous bien plus que ma maigre existence.
Le chemin vers Paris me fit goûter bien mieux sans doute que la Révolution ne le pût elle-même, ce goût piquant et vif de liberté.
Mon père m’avait confié la tâche de trouver en amont du Cortège Ducal la paille et le foin nécessaires au repas de l’attelage. Je partais alors dès l’aurore, en avant de la procession, où, flânant sur un âne qui m’avait miséricordieusement été attribué, je parcourais les chemins à la recherche de fermes qui pourraient, moyennant rétribution, subvenir aux besoins de notre caravane.
Le statut nouvellement acquis grâce à mon âne, les joies du vagabondage solitaire, la prise de conscience de l’immensité des territoires à découvrir m’emplissaient d’un sentiment de plénitude piqué d’une curiosité insatiable.
Les noms des villes, villages et bourgs chantaient à mes oreilles comme autant d’hymne à la découverte : Dijon, Saint Seine l’Abbaye, Baigneux les juifs, Ancy le franc, Fiogny la Chapelle…
Je fus également choqué par la misère partout rencontrée. Je fus attaqué et sévèrement rossé par une bande de gueux en haillons lors d’une pause près de Troyes pour un quignon de pain dur et noir. Je les vis s’arracher cette misérable pitance comme s’il se fut agit de quelque pépite inestimable.
Notre arrivée sur Paris, le 1er mai 1789, ne fit rien pour dissiper ce malaise. La ville regorgeait d’immondices, de rats, de gueux dépenaillés aux regards rendus déments par la faim. Moi qui ne souhaitais rien tant qu’errer sans fin dans ce méandre inconnu, synonyme de tant de prestigieux lieux et monuments, je n’osais m’aventurer les premiers jours plus loin que l’écurie royale où nous fumes accueillis.
La cathédrale Notre Dame, majestueux édifice lové au creux de la Seine, recelait, dès lors que l’on s’approchait de son parvis d’une foule bigarrée de quémandeurs, indigents et autres détrousseurs à la lame acérée.
Ma quête inutile me poussait toutefois à avancer toujours plus loin dans ma découverte et c’est ainsi que s’égrenait pour moi un printemps de flâneries, de rencontres et de merveilles putrides.
Ce n’est que le 26 juin que je fus happé à mon tour par l’histoire. Voila des jours déjà que je sentais enfler au cœur de la ville une effervescence grandissante. Mon incurie n’était que le fait de mon ignorance. Cela faisait une semaine déjà que l’Histoire soufflait un vent de colère sans nul autre pareil, que le tiers-états, les représentants de mon ordre, mes pairs, insoumis et fiers, proclamaient leur colère aux yeux du monde. Et moi, au cœur de ce souffle, n’y voyait goutte !
Ce 26 juin, donc, flânant comme à mon habitude toujours plus loin aux périphéries de la Capitale, je vis une masse de gens descendre vers la porte d’Italie, où je me trouvais alors. La foule, prise de panique hurlait et vitupérait tout un chacun de ces simples mots :
« Du pain, rendez le pain aux parisiens, nous avons faim »
Je vis alors contre qui la foule pestait : partout derrière moi se tenait des chevaliers en arme, leur uniforme rouge et bleu, leur tenue, leur regard, la hauteur de leur port sur leur chevaux rendus nerveux par la foule qui approche ; tout, montre en eux leur supériorité contre cette foule bigarrée et affamée qui se bat pour son pain.
Je me retrouve happé, bousculé, chaviré puis enivré et enfin fusionné par et avec la foule. Nous ne faisons plus qu’un, nous sommes le tiers-état, nous sommes le peuple de Paris, de France, peu importe, nous sommes unis et nous nous battrons pour notre pain, que le Roi veut nous voler, lui qui ne sait plus nous entendre.
Quelques jours plus tard, alors que j’ai trouvé parmi ces inconnus un sens à ma vie, je sais que je ne retournerai plus quémander mon maigre repas auprès du Duc. Je n’ai déjà que trop dormi, nous avons suffisamment courbé l’échine « voila mon pistolet, je saurais mourir glorieux » tel restera ma devise depuis ce jour du 12 juillet où Camille Desmoulins, le premier, nous exhortera, nous, le peuple de Paris, c'est-à-dire moi, qui n’y suis que depuis deux mois, à nous mettre en état de défense.
Et puis enfin, après deux jours de flammes, de sang et de rage aux barrières d’octroi, nous, peuple de parisiens affamés par un Roi despote depuis 1500 ans, nous gagnons notre première victoire. La plus belle qui fut, celle qui justifia toutes les horreurs à venir.
« - FEMME ! Du Rhum, nom de Dieu, j’ai soif ! Soif de vin, de Rhum ou de liberté mais que l’on étanche cette soif qui me ceint !
- ah et cette maudite mulâtresse qui est parti se terrer dans son lakou ou dans je ne sais quel ajoupa minable, qu’elle aille au diable !! »
18.05.1807
« - La guerre, tu entends, la guerre, mais qu’est ce que tu peux y comprendre, toi, à la guerre ?
- Arrête ty blanc la révolution, tu me fais peur quand tu parles comme ça
- C’est quoi ce nom encore, mais qu’est ce que vous avez tous avec les noms, nom de dieu ?
- C’est ton nouveau nomdfmayi, mwen ka apélé toa ti blan la révolution tu vois moi je m’appelle Dame de cœur et toi ti blan la révolution, c’est tout, y a rien d’autre à dire
- Vous me faites chier avec nos noms !
- Vous, c’est qui vous ? les nègres que tu transportes ?
- Vas-tu te taire, maudite métisse, fermer ce trou qui te sert aussi de sac à paroles, hors d’ici, disparais, maudite catin »
Je la prends par ces frusques et la jette hors de la chambre. Je bois encore une rasade de ce vieux tafia, je sors.
Une chaleur accablante alourdit chacun de mes pas, je me fonds dans la foule d’esclaves, de grands blancs aux costumes immaculés, agitant nerveusement un mouchoir pour les messieurs et un éventail pour ces dames devant leurs nez trop délicats pour la senteur enivrante des tropiques, mais je croise également des métisses, des mulâtres, quarteron, mamelouk, sang mêlé, sacatra, griffe…bref ! Voila trois jours que je ne suis pas sorti, mes yeux brûlent au soleil implacable de ce milieu d’après midi. Je respire à pleines narines cette puanteur sublime, ce mélange de poissons pourris, d’embrun, de pourriture et de sueur.
Les nègres processionnent attachés les uns aux autres par le cou, en file indienne. Ils défilent, depuis la grande bytasion jusqu’au trois mats, le ville de Nantes. Sur un trop grand nombre, de longues estafilades blanches zébraient ces corps noirs luisants de fatigue. Tous portaient au cou de vifs escarres.
C’était mon bateau. Un superbe trois mats où, tandis que les esclaves portaient à bras bananes, sucre, poivre, noix de coco, cannelle, peaux… les matelots montaient à l’artimon, profitaient d’un calme relatif pour hisser la brigantine, récuraient, pont, gaillard d’arrière, bastingue et chaque infimes parties de ce majestueux navire. L’océan caressait généreusement ses flancs, et, par inadvertance venait lécher ses plats-bords d’un coup de langue, taquin. J’aimais ce bateau et je vomissais rien qu’à voir les hommes qui l’habitaient. Tout cela sentait la misère, la souffrance et la mort. Combien des hommes qu’ils transportaient ont sauté en pleine mer pour retourner en Guinée ? Bon dieu ! Une dizaine, comme des forcenés, droit devant, plouf ! Au milieu de l’océan, retrouver la Guinée qui se trouve de l’autre coté de l’océan, au milieu de l’île sous la mer !
Foutue religion ! Tous les mêmes ces curés ! À bas le clergé !
Bon dieu, où j’ai mis ce foutu tafia.
23.05.1807
La sortie sur les quais m’a rudement malmené, je suis sorti groggy de ce face à face. Nous partons dans trois jours, et Dieu soit loué, les esclaves restent ici, au Brésil. Nous, nous repartons avec les fruits, les épices et les diamants pour retrouver enfin, après deux ans d’absence la France, l’Empire et Napoléon...
Comme égrenées sur l’horizon de la ville, de lourdes volutes de fumée piquaient l’air et obscurcissaient le ciel. Les colonnes tourbillonnantes donnaient à la ville un air de chaos, Paris brûlait, le peuple luttait, armé de fourches, de faux ou de cisailles et il se battait aveuglément contre le royaume le plus puissant d’Europe. Ce royaume qui étendait son emprise sur le monde entier, qui éblouissait de ses Lumières philosophes et penseurs, qui avait conquis par delà les mers des continents entiers. Cette puissance allait-elle vaciller devant la colère de quelques citoyens rendus aliénés par le désespoir et la faim ?
Le 13, alors que notre barrière d’octroi avait été saccagée puis incendiée par une charge de cavalerie, nous primes possession d’une réserve à grains. Nous avions réussi, uniquement par notre détermination à rendre notre ce qui était gardé par les forces de sa Majesté. Aucune violence, pas de sang, nous étions cent citoyens, ils étaient quelques militaires. Nous ne pouvions reculer car ce grain représentait notre salut, ils ne pouvaient plus, face à notre détermination, par la force, nous contraindre.
Je me couchais ce soir, au milieu des bruissements de colère, des fracas du canon et de l’odeur de la poudre, le ventre plein d’un pain arraché à l’oppresseur. Nous étions en train de prendre conscience de la mesure de notre force, nous qui n’étions rien, nous devenions l’avenir, le monde, la nation française en marche.
Cette matinée du 14 juillet 1789, cette journée qui transforma le monde à jamais, cet instant où, Goethe a pu en dire De ce lieu, de ce jour commence une ère nouvelle de l'histoire du monde, et vous pourrez dire : j'étais là !» commença pour moi par un défilé qui aurait pu être grotesque s’il n’avait été tragique : des femmes, mères, épouses, concubines braillent et vitupèrent à qui mieux mieux appelant les citoyens, hommes, femmes, jeunes, vieux, qu’importe ! à se munir d’une arme et à arracher par tous les moyens le pain qui leur manque pour nourrir leurs enfants.
Il est tôt le matin et une lueur blafarde laisse poindre faiblement une aura douce et légère sur les murs de Paris. Cette toute petite centaine de femmes braillardes et excitées, qui me tirent de mon sommeil et m’arrachent un juron ensommeillé vont bientôt emporter avec elles une foule grossissante qui finira par construire un fleuve humain dans les rues de Paris et qui, alors que nous sommes maintenant plus de vingt milles poussera, comme un bélier, les portes de l’arsenal de l’Hôtel des Invalides.
Nous étions affamés, nous nous sommes révoltés. Munis d’armes de poings et de fusils, nous devenons une armée au combat.
« De la poudre, il nous faut de la poudre » « Tous à la Bastille !»
« - et bien ti blan la révolution, là…tu t’es mis dans un drôle d’état depuis mon départ, qu’est ce que tu fais ? Qu’est ce qui t’arrive ? »
Je me retourne, je quitte un instant la place des invalides, le fort de la Bastille chancelant pour retrouver la lumière des jours.
Ma métisse se tient dans l’encablure de la chambre, accoudée d'une main au rebord de la porte, ses fesses rebondies terminant de l’équilibrer à l’autre rebord, une main sur la taille, elle me regarde. Elle garde ce reflet malin et enjoué dans les yeux où je lis également de l’inquiétude. Elle fronce les sourcils, fait la moue.
Elle porte un de ces plus beaux mouchwa tet, de magnifiques créoles enserrent son visage ciselé. Sa robe madras met en valeur ses formes rondes et généreuses. J’ai envie de la toucher. Mais plutôt que de tendre la main, je m’écroule, la tête sur mes deux mains. Et je pleure sans retenue, facilement.
J’ai l’impression que de voir ma métisse, de ressentir du désir pour son corps, ne serait-ce que l’espace d’un instant, a ouvert une vanne qui n’attendait qu’un rien pour céder, se briser et laisser couler un nouveau sentiment, encore inconnu. Les larmes me permettent de gagner du temps, de comprendre quelle est la nature précise de ce sentiment : de la honte pour ce que je suis devenu, de la rage, d’avoir laisser faire, de l’écoeurement pour la façon dont mes idéaux ont été utilisés par d’autres à leurs profits ?…Je ne sais pas, je cherche, dans mes larmes s’il s’agit de tout cela à la fois ou d’un petit quelque chose en plus.
Ma métisse s’approche, enserre ma tête contre son sein. Je sens son odeur, un doux mélange de musc, d’épices et de fleurs. Je l’entends chanter une berceuse dans une langue que je ne connais pas, ni créole, ni pinguin, ni Français, une langue aux accents gutturaux qu’elle dénoue délicatement dans sa bouche.
- « Dame de cœur, comment j’en suis arrivé là, toi, dis-moi ? s’il te plait, me laisse pas là sur cette dérive »
Depuis combien de temps n’avais-je pas pleuré ? Ai-je jamais réussi à appeler au secours ?
24.05.1807
Nous avons passé la nuit entière enlacés, moi, la tête penchée sur l’épaule tatouée de ma métisse, à lui raconter ce que je ne pouvais plus me cacher, toute ma vie, la prise de la bastille, la grande peur, la terreur, bien sur, mais surtout et avant tout la guerre, la violence, les canons, la poudre et puis la mort, la mort, la mort, insatiable et omniprésente.
Je lui ai raconté comment, combattant de la Liberté, je suis parti au travers de l’Europe, armé simplement de mon fusil, de mon courage, de ma liberté chèrement acquise pour faire éclore dans une traînée de joie les graines de l’arbre de la liberté. Et comment pourtant, je n’ai fait pendant toute cette vie que traîner la désolation et la mort, me servant de l’étendard de la liberté, de l’égalité et de la fraternité pour servir les intérêts d’autres tortionnaires, de nouveaux empereurs. Jusqu’à soumettre à l’esclavage d’autres hommes ! Comment ai-je pu être si naïf ? Quand me suis-je trompé ?
Elle, elle a passé sa nuit à m’écouter, me calmer, me bercer, la main dans mes cheveux, sur ma joue, assise, là, à côté de moi, simplement prête à partager ma douleur.
Et puis, lorsque j’ai eu fini, lorsque je lui ai eu tout raconté du chemin qui mène de la liberté à l’esclavage, lorsque j’ai remonté avec elle tout le parcours qui, de la libération de mes propres chaînes à la réhabilitation de l’esclavage, m’a mené à ces bras, seulement alors elle m’a répondu. Et sa réponse était un chant, un murmure, une folie.
01.06.1807
Le Ville de Nantes a quitté Fortaleza le 26. A son bord, toutes les richesses du Brésil arrachées par la force et le mépris pour nourrir ou divertir les grands hommes d’un autre monde.
Il arrivera en France dans plusieurs mois après avoir massacré combien d’hommes ? Combien de familles entières endeuillées ? Et pour quoi ? Du poivre, des céréales rares ou encore inconnues ?
C’est plus que ça diront certains, c’est le progrès, l’avenir, c’est la grande marche du monde futur qui se dessine dans cette économie. Moi qui ai vu le prix à payer, j’ai choisi.
Je n’y retournerai pas. Aujourd’hui, nous avons mouillé notre goélette, un magnifique bateau de pêche sur lequel je dois encore apporter des réparations de fortune au mat de misaine, sur la baie ouest de l’île de Ilha Fernando de Norhona. Nous avons quitté Fortaleza il y a deux jours seulement, cap à l’est, direction l’atol das rocas, un petit bout de caillou surgi de nul part où nous n’avons pu ni voulu aborder.
Ici à Fernando de Norhona, Dame de Cœur pêche quelques poissons à l’entour, l’eau dessine des arabesques le long du corps nu de ma métisse, elle se rapproche du bateau, s’accroche à la corde à nœud qui pend hors de la goélette, elle se hisse à moitié hors de l’eau, ses seins affleurent au trois quart, elle me sourit. Elle tient dans la main un superbe poisson, certainement un petit marlin blanc. Elle monte sur le bateau, son corps entièrement recouvert d’une fine pellicule de mer, elle continue de me sourire, s’approche, m’embrasse.
« - nous partons, dit-elle »
Je me lève, hisse la grand’voile. Remonte l’ancre. La voile aurique faseye, je prends la barre, borde la grand’voile. Le bateau se lève, il pousse l’eau doucement, accélère. Je hisse la voile de misaine, porte de travers.
Ma métisse m’invite du regard.
Il est temps que je rentre à bord.
Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique :
Chronique : par Xavier Braeckman
E-mail :