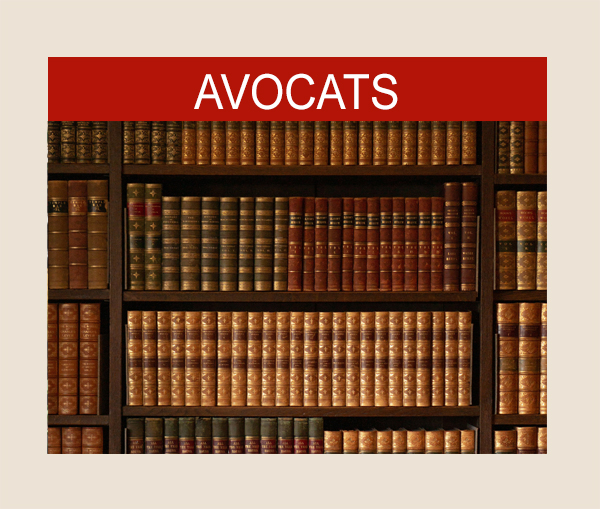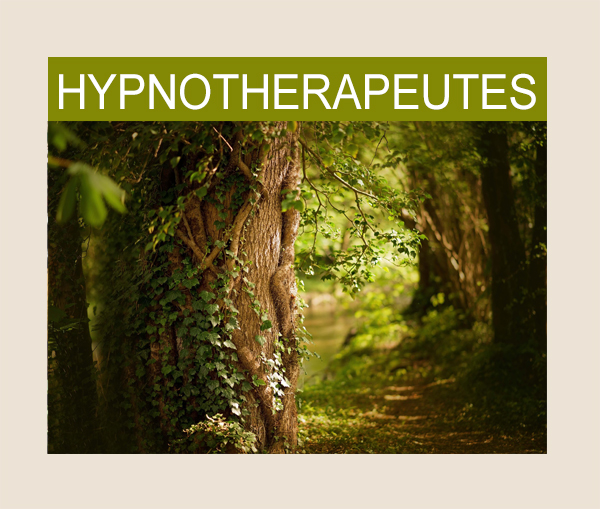Par : Xavier Braeckman
Raymond et Jeannette habitaient à Marsannay la Côte. Un petit pavillon mitoyen de banlieue, près de Dijon.
Le lotissement comportait au bas mot deux cents habitations, toutes exactement identiques, un alignement interminable de maisonnettes qui serpentait sans interruption dans la plaine viticole.
Seuls les carrefours, les places publiques et quelques parkings rompaient cette soif de construire.
C’était un quartier moderne, plein d’espoir, bâti suivant une technique révolutionnaire : en quelques mois seulement des grues sur rails construisaient dans des temps records des havres de paix pour des centaines de salariés honnêtes et travailleurs là où n’existaient encore que terrains vagues et terres agricoles.
C’était l’avenir, le bonheur à portée de tous : une maison, un petit jardin, un garage, un étage pour les chambres: deux pour les enfants, une pour les parents, deux toilettes, une en haut, une en bas, une cuisine spacieuse et aérée qui donnait sur le jardin, un séjour aux murs blancs. Un grand escalier en bois ouvrait sur l’étage et donnait, du salon, une impression d’espace. Pas de cloisonnement, pas de mur.
Une architecture nouvelle pour tous, une société moderne et riche, en pleine reconstruction.
Ici, les voisins sont charmants et peu bruyants. Polis et discrets.
On organise régulièrement avec ceux d’à côté et d’en face des barbecues, le dimanche, chez les uns ou les chez les autres, suivant l’humeur, respectant des règles tacites de bonne éducation.
On se détend alors d’une dure semaine avec un petit vin ramené de la route des grands crus qui passe, là, juste derrière le lotissement, et qui mène à Beaune. Chacun y a une adresse, une connaissance, un petit vigneron qui arrondit discrètement ses fins de mois avec le beau-frère, l’ami de la femme, le collègue du neveu…
Du vin sans étiquette rond et fruité qui vous glisse dans le gosier comme un petit jésus en culotte de velours.
Tout cela, et plus encore, c’était leur quartier à Raymond et Jeannette, la SOGEC, SOciété de GEstion et de Construction ou quelque chose dans ce goût là. Un nom moderne, pour une vie meilleure, gagnée à la sueur de son front.
Et puis le cours des choses avait changé.
Il y avait eu la première crise pétrolière en 1974. Et puis la deuxième, en 1979...
La machine s’enraye, l’avenir n’a plus le même air radieux, on entend parler du chômage au poste. Les usines ferment, les entreprises licencient les vieux, les jeunes ne trouvent plus de travail.
Bah, les jeunes…C’est encore un autre problème. Ça…
Ou plutôt non, c’est bien ça, le fond du problème : la crise de l’énergie, l’inflation, les taux d’intérêts, le chômage, Mitterrand qui va tout régler avec les 39 heures et d’autres idées encore…tout cela et d’autres grandes théories ça ne prouve qu’une seule chose : quand on n’a pas, chacun, la valeur du travail vissée au corps, quand on n’a pas connu des années de vache maigre et qu’on est né une cuillère en argent dans la bouche à tout critiquer et tout vouloir révolutionner en plus, et bien tout finit par s’écrouler, y a plus de repères, plus de valeurs morales, plus rien. Rien que « la chienlit ».
Alors forcément au bout d’un temps, l’économie, à force de paresser en rêvant à je ne sais quelle chimère, et bien, elle fait comme tout le reste, elle s’écroule. Et qu’on ne vienne pas dire que c’est la faute des mines d’acier anglaises qui produisent plus ou du pétrole qui est trop cher.
Et puis après tout, c’est peut-être pas un mal, à bien y réfléchir. Peut-être bien que ça leur remettrait les idées en place à certains, de bouffer des pâtes pendant un temps.
Ils rêveraient peut-être moins d’un monde meilleur et ils travailleraient peut-être un peu plus s’ils avaient moins été gâtés pendant toutes ces années.
Toutes ces années, lui, Raymond, il avait travaillé. Il s’était « fait » tout seul, à la seule force du poignet, sans démériter, jamais, pas un jour d’absence pour maladie, pas une manifestation, pas une grève. Tous les jours sur le pont, levé aux aurores, à construire petit à petit le monde qui est le sien.
Il ne doit rien à personne, Raymond, non,
Absolument rien. Il est devenu ce qu’il est en partant de rien.
Parce qu’il avait fallu tout reconstruire après la guerre, et qu’il s’y était mis, lui, d’arrache pied. Qu’il avait su mouiller la chemise.
Que c’était la seule valeur et qu’elle l’avait jamais déçue, la sueur.
Et quand les choses avaient été difficiles, il avait su faire les bons choix, il s’était pas mis à geindre que la vie était injuste, il s’était pas syndiqué, pas révolté contre le système, pas laissé pousser les cheveux.
Il avait retroussé les manches et il avait foncé, toujours. Y avait plus de travail là où il était ? Qu’à cela ne tienne, il était parti ailleurs. Et il avait recommencé. Et s’il fallait le faire à nouveau, il le referait.
Oh, bien sûr, il avait pas grand chose, bien sûr, il n’avait pas sauvé le monde ou construit un monde peuplé de fleurs. Mais ce qu’il avait, il l’avait gagné, et à partir de rien, et c’était ça qui comptait, plus que tout au monde.
Et ces petits riens, c’était sa vie et elle lui convenait parfaitement : une femme douce, gentille, aimante et travailleuse, qui l’attendait jusqu’à point d’heure quand il partait des jours entiers dans ces tournées de VRP, une petite maison agréable à la SOGEC qu’il venait tout juste de finir de payer l’année dernière, un bas de laine qui lui permettait de voir venir et qui lui avait permis de s’offrir sa nouvelle Citroën berline,
Une GS sport intérieur cuir, un nombre de chevaux sous le capot de quoi faire blêmir de jalousie Ben Hur sur son char. Un vrai petit bijou, une pure folie comme disait Jeannette,
Mais quoi ! A cinquante sept ans, on a quand même le droit de s’offrir ce genre de petit plaisir, pas vrai ?
Et puis bientôt,
Dans trois exactement, la retraite, une retraite bien méritée, chèrement acquise et qu’il voyait d’ici, tiens ! Les parties de pétanque avec les copains sur la place Gaston Roupnel, les sorties pêche sur les bords de la Saône, les virées dans les caves avec les copains, Régis, André, et toute la bande.
Et puis d’ici sept ans, quand Jeannette aura fini de travailler, peut-être bien qu’ils pourront se payer un petit voyage en amoureux dans les îles ou ailleurs, juste pour profiter du bon temps, couler des jours heureux, paisibles.
Raymond en était là de ces pensées lorsqu’il fut interrompu dans ces rêveries par la nouvelle secrétaire du directeur général.
Il avait été convoqué la veille, vers midi, alors qu’il partait manger avec des collègues. Ils avaient croisé le directeur des ressources humaines (ressources humaines, tu parles d’un titre ! Ça leur allait pas à cette nouvelle équipe d’être responsable du personnel ? Il leur fallait du ronflant, du clinquant, du tape à l’œil, fallait qu’ça en jette, fallait qu’ça soit moderne, ampoulé c’était bien la seule chose dont ils étaient capables) qui avait intercepté Raymond pour lui demander de bien vouloir se rendre à un EPR (entretien personnalisé de remobilisation) avec le directeur.
Ça faisait maintenant six mois qu’il l’attendait ce rendez-vous et voilà qu’il lui tombait dessus du jour au lendemain ! Et bien, pas de problème. Il irait à son entretien personnalisé, ils verraient s’il avait besoin d’être remobilisé et il lui expliquerait au nouveau directeur, posément et objectivement, comment il avait su, en quinze ans de boite tisser des liens amicaux avec l’ensemble des fournisseurs, comment il avait réussi, parfois à force de repas d’affaires un peu trop arrosés, à se tisser un réseau de clientèle solide et fiable. Comment il était parvenu, en quinze ans, à passer de simple VRP à responsable de la clientèle industrielle et ce que ça voulait dire pour des grosses sociétés comme Calor ou Rowenta que de travailler avec monsieur Bracmand pour tout ce qui concernait la machine à coudre.
Non, vraiment, il n’avait pas à s’en faire. Cette nouvelle équipe implantée artificiellement par la maison mère en Allemagne jouait les gros bras et maintenait une pression permanente à coup de menace au licenciement mais il faisait partie des piliers de l’établissement et ils avaient besoin, dans l’équipe, d’hommes sérieux et qui connaissaient leur affaire.
Ce qu’il était, nom de dieu ! Un homme de terrain qui avait su s’imposer avec poigne grâce à une compétence indiscutable.
Et puis le directeur lui avait parlé.
Peu importe les raisons invoquées, peu importants les arguments échangés, les négociations entamées. Il avait pris sa décision bien avant de rencontrer Raymond et lui avait asséné la réalité comme on plante un poignard dans l’œil d’un lapin pour le saigner.
Il était trop vieux. Dépassé, fichu. Un poids mort pour la société. Il était viré.
Point.
Ces indemnités lui seraient versées avec son dernier salaire, pour solde de tout compte. La société prendrait en compte son ancienneté et lui demandait de prendre son reliquat de congés payés en fin de contrat. Il serait inutile et coûteux à la société qu’on les lui payât.
Merci, monsieur Bracmand. Et bon courage dans vos recherches.
Rebus.
Voilà le seul mot qui s’affichait en lettres de feu devant la vision embrouillée de Raymond. Cette image avait étouffé dans l’œuf tout le reste. Il était resté là, assis sur son fauteuil en cuir amovible, pantelant, sans vie, sans hargne, sans volonté ni énergie devant ce petit directeur d’une petite quarantaine d’années.
Et puis, il avait finalement réussi à sortir du bureau. Il s’était servi un café dans la machine installée dans le couloir et, lorsque il avait vu Evelyne, une petite comptable d’à peine trente ans mignonne et fraîche comme la jeunesse personnalisée, remonter l’allée de bureaux vers lui, il s’était redressé, avait bombé le torse, rentré le ventre et lui avait sorti, comme d’habitude, son plus beau sourire, façon Gabin en lui lançant :
« Alors, petite… ? » Ce à quoi elle avait répondu avec un air mutin « heureuse, Raymond, comme toujours, heureuse, je vous remercie bien de votre attention ». Il avait ri alors, d’un rire franc et sonore, la gorge largement déployée, tout en mettant sa main dans la poche de son pantalon l’air tout à la fois sûr de lui et décontracté.
Il souffla alors sur son café, l’avala d’une traite, jeta le gobelet dans la poubelle située à deux mètres de là et reprit le cours normal de sa journée. Un sourire confiant aux lèvres.
Mort, inutile, jeté à terre comme un rien. Trente ans de travail, d’expérience, de sueur, balayé, d’un seul coup, comme ça.
Pfuit.
Comme un mouchoir trop plein que l’on jette par la portière pour ne pas salir sa voiture. Comme ces vieillards inutiles et pesants qu’on abandonnait au bord des routes parce qu’ils freinaient la marche de la famille vers un lieu plus sûr pendant l’Exode, en quarante.
1940. Il avait dix sept ans à cette époque. Il avait devancé l’appel et menti sur son âge cette année là pour pouvoir faire son devoir de patriote et combattre l’ennemi qui menaçait la France. Il avait été prisonnier, blessé, humilié dans les camps de travail en Allemagne. (Accueilli comme un collabo à son retour des STO par une famille qui avait profité largement du marché noir, quoi qu’ils en disent).
Depuis ses dix-sept ans, il n’avait cessé de se battre, et voilà qu’un jeune con l’avait traîné dans la boue et mis à terre, KO, sans même un regard en arrière quand il s’était effondré dans la fange.
Il devait se relever, reprendre le combat. Tout cela n’était qu’une mauvaise passe, un accident de parcours, une épreuve supplémentaire imprévue, il était de la race des gagnants, il n’était pas un vieux chiffon qu’on abandonne en cours de route.
Et au combat, on se retrouve toujours seul face à l’ennemi, face à soi même, à devoir surmonter sa peur. Et il ferait face.
Seul.
Il ne servait à rien d’inquiéter ses proches.
De sentir leur pitié, leur fausse compassion, leur supériorité honteuse de bons travailleurs, face à l’homme abattu qu’il était devenu. En une heure. Un claquement de doigts.
Clac.
Le soir, il revint comme tous les soirs avec une baguette achetée au Timi, la petite supérette du quartier, il prétexta une migraine. Se coucha.
Il se leva à six heures, prit son déjeuner et partit.
Partir où ?
Pour quoi ?
Pour qui ?
Pendant combien de temps ? Trois jours, une semaine, sans doute plus, il recommença le même manège, inlassablement.
Se lever, se raser de prêt, s’habiller en costume gris, d’une coupe irréprochable, ouvrir la porte du garage, faire chauffer la voiture. Saluer les voisins.
Faire semblant, faire comme si.
Comme s’il était toujours un homme, un homme à part entière. Un homme utile à la société, qui subvenait aux besoins de sa famille et que sa femme pouvait regarder le soir avec fierté quand il rentrait, énervé et fatigué d’avoir trimé toute la journée.
A plusieurs reprises, Il avait discuté avec le voisin d’en face, monsieur Goudbrose, organisant la partie de boules du dimanche, racontant des anecdotes du bureau, se plaignant des embouteillages, fanfaronnant devant des succès commerciaux imaginaires, puis, soudainement affolé de voir l’heure qui tournait à sa montre (une lip) s’était précipité, pressé et afféré vers sa GS.
Pour une destination inconnue, vers une journée noire et vide, une journée de mort vivant, sans but et sans désir. Une journée de chômeur. De perdant. De vieux con abandonné.
Toutes ces journées passées à arpenter le bitume dijonnais n’avaient qu’un seul but, fuir l’heure sombre où il devrait rejoindre ce troupeau de perdants qui arpentait le pavé devant les bureaux de l’ANPE. Cette bande de fainéants et de moins que rien, ces ratés qui mendiaient l’argent du contribuable pour pouvoir survivre au crochet de la société.
Et voilà que lui, Raymond Bracmand, ancien combattant, meneur d’hommes, homme à femmes, allait devoir rejoindre cette bande d’incapables, fainéants et profiteurs.
Il passa plusieurs fois devant, habillé d’un impeccable costume croisé beige clair, chaussures italiennes en cuir souple aux pieds.
Cent fois, la nuit, il s’était vu faire, décliner son identité, remplir un formulaire, attendre son tour en regardant distraitement les offres inscrites aux panneaux d’affichage, et puis au moment où le courage commençait à venir, qu’il se sentait devenir suffisamment fort pour affronter cette ultime épreuve, il avait senti le bras de Jeannette effleurer son épaule robuste et puissante ou avait perçu son haleine se coller à son torse, confiante.
Et il avait perdu courage. Il ne pourrait pas affronter son regard intensément déçu et surpris. Cette lueur de gêne timide cachée au fond des yeux.
Alors il avait continué ce mensonge, s’enfermant toujours plus profond au fond de cette honteuse solitude. Arpentant les rues, souriant le matin à un voisinage aveugle qui n’en avait rien à foutre, impeccablement lustré des pieds à la tête, douché, parfumé, le regard fier, puis s’enfonçait doucement, de rues en rues vers un nulle part sans fond, anonyme et seul, aiguisant son désespoir au fil des heures.
Et puis, un matin, dans son lit, par une de ces chaudes journées de mai, il s’était tourné brusquement vers Jeannette, l’avait agrippé par le bras, le lui avait serré avec une force démesurée, avait montré dans un geste d’impuissance sa poitrine. Il avait frappé par trois fois son torse.
Et il s’était écroulé. Sans connaissance. Victime d’une attaque cérébrale.
La moitié du cerveau à jamais détruite.
J’avais six ans ce jour là, c’était la première fois que je voyais mon père pleurer.
Il partit seul pendant plusieurs jours pour voir mon grand-père qui était très malade.
Lorsque je revis mon papy il avait un nouveau regard, tout à la fois étrange et très doux. Un regard que je ne connaissais pas mais qui me rassurait. On m’avait tellement mis en garde, tellement préparé à cette première confrontation, à ce nouveau papy, que j’avais eu peur. Peur de cet homme « malade », peur de…peur de ce que je ne pouvais comprendre et à quoi on me confrontait pourtant. Lorsque je le vis, je fus rassuré. Rassuré de voir qu’au fond l’essentiel était préservé. Rassuré de savoir que je saurais faire face à ce nouvel homme si doux et si fragile, si plein d’amour qu’il semblait en être écrasé dans son fauteuil. Un amour que je n’avais jamais vu auparavant, jamais avec autant de force.
La maladie l’avait frappé et cloué dans un fauteuil roulant pour toujours, elle lui avait ôté la parole, la faculté d’être entièrement maître de soi. Mais pour moi, je crois qu’elle avait en échange ajouté un je ne sais quoi de vague et de doux, une lueur de bonté qui n’y était pas auparavant. Et qui me rassurait. Et qui était tout ce que je cherchais chez un papy.
Il ne cessait de me regarder et pleurait à grands sanglots. De grosses larmes d’enfants coulaient sur ses joues, il bredouillait des mots que je ne comprenais pas.
Nous étions allés dans une maison que les adultes appelaient de repos.
Un grand soleil de printemps inondait le jardin de cette étrange maison. Le chemin qui menait du jardin à la grande grille en fer forgé de l’entrée était fait de petits graviers qui crissaient sous les chaussures. Je m’amusais à shooter dans les graviers pour faire de grandes traînées marron dans le gravier gris, ces traînées m’amusaient, elle me faisait penser aux « traces de pneu » que je découvrais souvent le soir dans mes slips. Mon père m’a demandé d’arrêter. On n’était pas là pour jouer. Il avait pleuré, ma mère aussi. Je ne comprenais plus ce qu’il y avait de si triste. Pas après avoir vu son regard.
J’ai vingt huit ans aujourd’hui. Il y a de nouveau du gravier gris qui crisse sur mes chaussures… Il n’y a plus de soleil, plus de jardin, plus de grands arbres en fleurs. Il fait froid et gris. Les arbres sont noirs et entièrement rongés par la morsure de l’hiver. On enterre mon grand-père ce matin.
Nom de dieu ce qu’il fait froid.
Raymond est allongé, dans une petite chambre recouverte d’une moquette pourpre, quatre cierges brûlent dans la pièce. Il lui manque un bras et une jambe, emportés par plus de vingt ans de maladie.
Je frappe encore le gravier du pied, je ne m’amuse plus.
N’aie pas honte, Raymond, ce sont eux qui se sont trompés. Repose enfin en paix.
FIN
PHOTO : Silvia Fabbri
Pour en savoir plus sur l'auteur de cette rubrique :
Chronique : par Xavier Braeckman
E-mail :